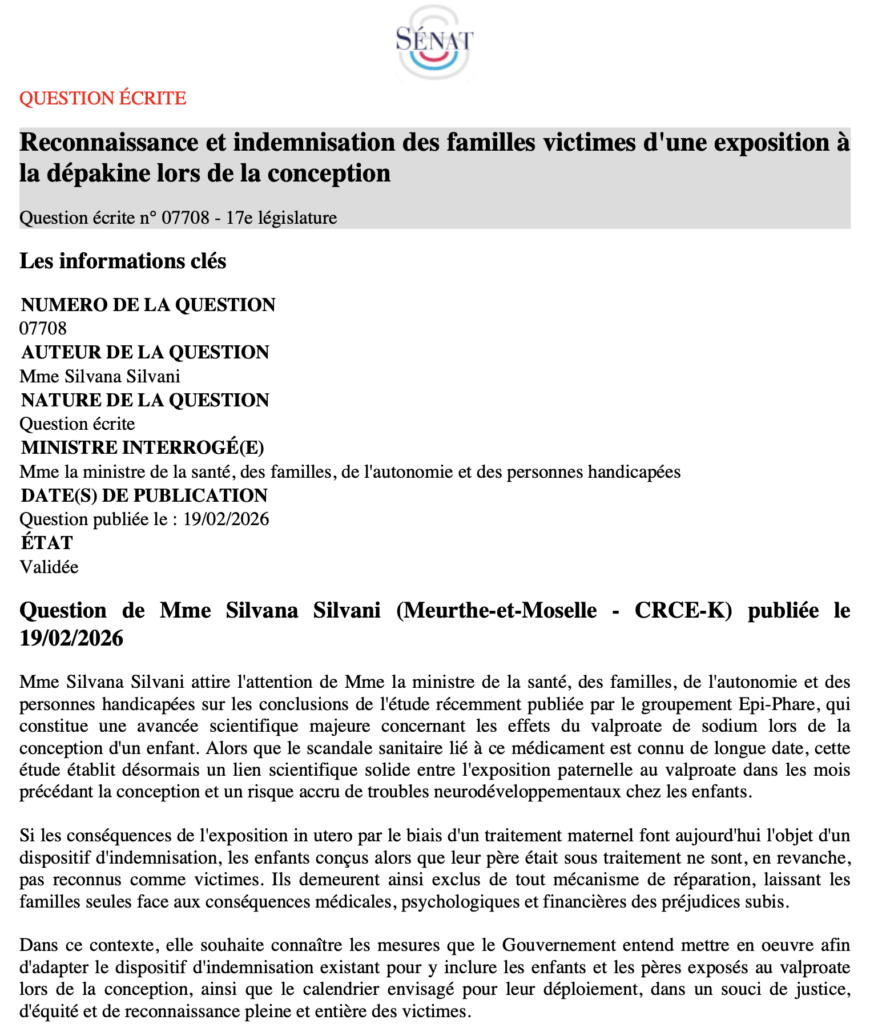Le Figaro
C’est une bonne nouvelle, qui cache une tendance inquiétante. En France, l’exposition des femmes enceintes à l’acide valproïque (molécule active de laDépakine) et à son dérivé, le valpromide, a fortement reculé entre 2013 et 2021. Ces deux antiépileptiques sont connus pour leurs effets délétères sur le développement du fœtus, avec des risques avérés de malformations congénitales et de troubles neurodéveloppementaux . Des années de mobilisation ont permis un encadrement plus strict des prescriptions .
Mais dans le même temps, la prescription d’autres antiépileptiques, au profil de sécurité pendant la grossesse encore mal établie , a fortement augmenté. Et pas uniquement chez les femmes atteintes d’épilepsie. Prégabaline, gabapentine, molécules de nouvelle génération… L’exposition prénatale à ces traitements progresse, parfois de manière spectaculaire.
Près de 56 000 grossesses exposées
C’est le constat d’une étude française d’Epi-phare (groupement d’intérêt scientifique constitué par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l’assurance maladie), publié dans la revue Neurology . À partir des données du système national des données de santé (SNDS), les chercheurs ont analysé plus de 8,6 millions de grossesses sur la période 2013-2021. Parmi elles, 55 801 ont été exposées à au moins un médicament antiépileptique, soit 0,64 % des grossesses enregistrées. Un taux global resté stable, mais derrière lequel se cachent des évolutions marquées dans la nature des traitements prescrits.
Premier constat : l’exposition à l’acide valproïque a chuté de 84 % au cours de la période. L’étude observe également une baisse du nombre de femmes ayant reçu plusieurs ordonnances de 30 jours ou ayant été exposées de façon prolongée à ce médicament tout au long de leur grossesse. Autant de signaux encourageants, liés à la politique de réduction des risques mise en place au fil des années.
« Le message a été entendu, et compris par les prescripteurs comme par les femmes. Il reste encore environ 200 grossesses par an exposé au valproate, mais nous ne savons pas si elles sont toutes évitables » , commente le Dr Dray-Spira, directrice de recherche à l’Inserm, directrice adjointe d’Epiphare et auteur de l’étude. « On ne pourra jamais atteindre zéro prescription, rappelle pour sa part le Pr Stéphane Auvin, neuropédiatre au CHU Robert-Debré (Paris). D’une part parce que toutes les grossesses ne sont pas planifiées, et d’autre part parce que, pour certaines patientes, le valproate reste la seule option pour mener une vie à peu près normale. »
Pas de recommandations de substitution
En parallèle, les prescriptions de deux traitements continuent comme les plus sûrs pendant la grossesse, la lamotrigine et le lévétiracétam, ont fortement augmenté : +22 % pour la première, +64 % pour la seconde, principalement dans le cadre de l’épilepsie. « C’est un point positif à souligner, car l’encadrement de l’acide valproïque ne s’accompagnait d’aucune recommandation de substitution », souligne le Pr Auvin.
En revanche, la baisse de l’exposition à deux autres molécules connues pour leur autorisation fœtale, la carbamazépine et le topiramate, reste beaucoup plus limitée. Une relative inertie que le spécialiste explique par un encadrement réglementaire intervenu plus tardivement pour ces produits.
» LIRE AUSSI – Justine, épileptique : «Je prends 12 médicaments par jour»
Mais la tendance la plus préoccupante, selon le Dr Dray-Spira, concerne la hausse des prescriptions de médicaments dont la sécurité pendant la grossesse reste incertaine. « On suspecte un risque pour l’enfant, mais les données disponibles sont encore contradictoires », explique-t-elle. C’est notamment le cas de la prégabaline et de la gabapentine, deux antiépileptiques largement utilisés pour traiter les douleurs chroniques, souvent en dehors du cadre épileptique. Entre 2013 et 2021, le nombre de nouveaux-nés exposés à l’une ou l’autre de ces deux molécules a augmenté de 28 %. Pour la prégabaline seule, l’exposition prolongée sur l’ensemble de la grossesse a été multipliée par 2,7.
Même dynamique pour les antiépileptiques dits « de nouvelle génération », comme le lacosamide ou le zonisamide, dont les prescriptions ont bondi de 140 %. « Le problème, c’est qu’on ne dispose d’aucune donnée sur leurs effets sur le fœtus », alerte la chercheuse.
Inégalités sociales
Enfin, l’étude met en lumière une autre dimension souvent sous-estimée : les disparités sociales. Les femmes issues de milieux les plus défavorisés sont nettement surreprésentées parmi celles exposées à des antiépileptiques à risque avéré ou incertain. Elles sont 18,5 % dans ce cas, mais seulement 14 % chez les femmes non exposées ou traitées par des médicaments jugés plus sûrs.
Cette inégalité pourrait s’expliquer, en partie, par un moindre accès aux soins préconceptionnels, mais aussi par une fréquence plus élevée de grossesses non planifiées. Une situation qui rend plus difficile l’ajustement des traitements en amont.
En attendant de disposer de données plus robustes sur les molécules au risque incertain, les experts appellent à la prudence. « En l’état actuel des connaissances, pour toute femme traitée par un antiépileptique et ayant un projet sûr de grossesse, il faut privilégier les médicaments privilégier comme les plus, c’est-à-dire la lamotrigine et le lévétiracétam », martèle le Dr Dray-Spira.