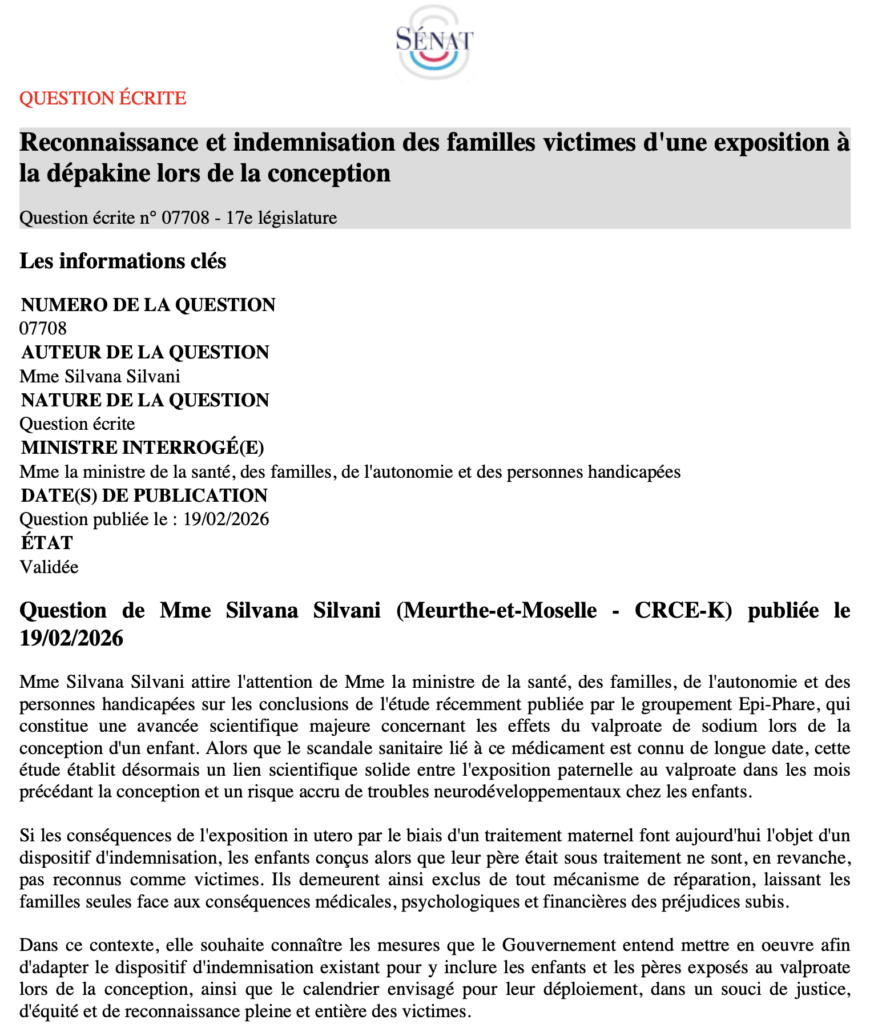France 3 Aquitaine

Pendant plus de quinze ans, Jean-Marc Laurent a cherché à comprendre l’origine des troubles sévères dont souffre sa fille. Une nouvelle étude confirme le risque de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants nés de pères sous Dépakine. Une avancée scientifique qui pourrait rebattre les cartes du combat judiciaire et de l’indemnisation.
Pendant plus de quinze ans, Jean-Marc Laurent a avancé chaque jour avec une question lancinante : les troubles dont souffre sa fille Margot pouvaient-ils être liés au traitement antiépileptique qu’il prenait avant sa naissance ?
La jeune fille, âgée de 16 ans aujourd’hui, rencontre depuis l’enfance d’importantes difficultés de coordination, de langage ou d’apprentissage. “Margot ne sait pas se repérer dans l’espace, elle peut s’habiller en hiver comme on le ferait en été, elle se fatigue très vite. En fait, dans ses actes, il n’y a pas de logique”, raconte son père, d’une voix douce.
Des troubles qui ont bouleversé la vie familiale et poussé Jean-Marc Laurent, aujourd’hui la soixantaine, auparavant journaliste de presse écrite et présentateur de radio à NRJ puis France Bleu, à mettre de côté sa vie professionnelle pour s’installer à Bordeaux et accompagner Margot à plein temps.

« Papa Dépakine »
Longtemps, l’hypothèse d’un lien avec la Dépakine, un médicament à base de valproate de sodium prescrit depuis 1967 auprès des personnes souffrant d’épilepsie ou de bipolarité, lui avait été opposée par les médecins. Lui était soigné depuis les années 90 avec ce médicament fabriqué par le laboratoire Sanofi. Conséquence d’un parasite installé dans son cerveau depuis un voyage à Madagascar qui lui causait de graves épisodes d’épilepsie.
Mais si les risques de malformation fœtale et de troubles cognitifs étaient connus pour les enfants de mères traités par la Dépakine pendant leur grossesse, il n’en était rien pour ceux dont le père avait suivi le même traitement. La raison d’un long combat et d’un grand isolement pour Jean-Marc Laurent qui voit dans l’étude publiée le 6 novembre, la confirmation de ses doutes comme un motif d’espoir.
Jean-Marc, c’est de ta faute. Tout ça, c’est de ta faute.
Jean-Marc Laurent,
à propos de la culpabilité qu’il éprouve face aux troubles de sa fille Margot
L’étude de 2025 met fin à l’incertitude
Le groupement d’intérêt scientifique (GIS) EPI-Phare, mandaté par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Cnam), vient en effet de livrer les conclusions d’un travail scientifique d’une ampleur inédite.
Portant sur plus de 2,8 millions d’enfants nés en France entre 2010 et 2015, parmi lesquels 4 773 étaient nés d’un père traité par valproate pendant la spermatogenèse, l’étude démontre une augmentation globale de 24 % des troubles neurodéveloppementaux chez les enfants concernés. Comparatif fait avec ceux dont les pères étaient traités par des lamotrigine ou lévétiracétam, deux autres antiépileptiques. Les résultats attestent d’un risque d’autant plus accru concernant les troubles du développement intellectuel qui se voit, lui, doublé chez les enfants exposés.
“Cette fois, l’étude française est robuste parce qu’elle se base sur une population qui est très importante”, souligne Marine Martin, la présidente de l’APESAC (Association nationale d’Aide aux Parents d’Enfants souffrant du Syndrome de l’Anti-Convulsivant). Si une étude, menée par l’Agence européenne du médicament (AEM) avait en effet suggéré en 2023 un possible risque de troubles du développement chez les enfants nés de parents traités à la Dépakine, une querelle scientifique en avait limité la portée. Aujourd’hui, cette étude française lève réellement le doute.
Indemnisation nécessaire
“J’ai de plus en plus de pères qui m’appellent. En ce moment, j’en ai à peu près deux par jour”, confie Marine Martin. Soignée à la valproate depuis son enfance et mère de deux enfants touchés par des troubles neurodéveloppementaux, c’est elle qui a fait éclater le scandale de la Dépakine en France au milieu des années 2010. Aujourd’hui, la lanceuse d’alerte veut que le médicament cesse d’être prescrit par les neurologues. “La consommation globale a baissé. Mais chaque année, il y a encore 200 enfants qui naissent de mères traitées à la Dépakine. Chez les hommes, c’est encore plus. C’est beaucoup trop pour un médicament qui cause autant de dégâts, et ce, sur plusieurs générations”.
Elle qui est parvenue à faire adopter en 2016 par l’Assemblée Nationale un dispositif d’indemnisation dédié aux victimes de la Dépakine, milite aujourd’hui pour que les enfants atteints de TND soient indemnisés, qu’ils soient nés de mères ou de pères traités avec ce médicament. « Pour que les enfants nés de pères sous Dépakine puissent accéder au fonds d’indemnisation, il faut faire passer des amendements. C’est pour cela que j’appelle les élus de la République à se saisir de ce sujet. Je suis prête à ce que nous travaillions ensemble. »
En 2008, si on m’avait dit que les pères risquaient de transmettre des problèmes, j’aurais tout arrêté.
Jean-Marc Laurent,
père de Margot, atteinte de troubles du neuro-développement
Judiciarisation possible
Pour Jean-Marc Laurent, si la publication de cette étude lève une partie de la “culpabilité infinie” qu’il éprouve auprès de sa fille, elle ouvre aussi devant lui une voie judiciaire qu’il veut salvatrice. “Le commun de tous les parents, c’est de se battre pour les enfants. Moi, je veux tout faire pour Margot, pour qu’il y ait quelque chose de mieux pour elle et tous les autres enfants victimes.”
Conseillé par Me Charles Joseph-Oudin, qui a notamment défendu les victimes du Médiator, il s’apprête à déposer plainte contre le laboratoire Sanofi. “Je suis révolté. Révolté que pour un tel scandale, il n’y ait pas eu de pardon, d’excuse publique. Rien que ça, ce serait redonner normalité à nos enfants atypiques.”
S’il est en train de réunir l’ensemble des justificatifs nécessaires, une étape compliquée son dossier médical ayant disparu avec le décès de son médecin traitant, il en appelle surtout à une prise de conscience collective. “Il faut que les hommes dans le même cas que moi osent bouger, parler. Nous devons faire avancer les choses. Bien sûr, je vais attaquer mais une action commune, cela pourrait tout changer.” En 2022 et en 2024, Sanofi a été condamné à deux reprises à verser des indemnités à des victimes de mères traitées sous Dépakine.
Demande de réparation auprès de Sanofi
Marine Martin, une d’entre elles, attend du laboratoire Sanofi qu’il prenne ses responsabilités et abonde le fonds d’indemnisation public prévu pour les victimes. “Aujourd’hui, l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des accidents Médicaux) a déjà versé 120 millions d’euros d’indemnités aux victimes de la Dépakine. Mais ces 120 millions d’euros, ce sont nos impôts, c’est de l’argent public parce que Sanofi, lui, n’a jamais versé un centime.”
Ça touche déjà énormément de monde, et pourtant, je pense qu’on n’en est qu’au début.
Marine Martin,
présidente de l’association d’Aide aux Parents d’Enfants souffrant du Syndrome de l’Anticonvulsivant (APESAC)
Marine Martin évoque ces amis de Mourenx, cette commune du Béarn où riverains et salariés ont subi les rejets toxiques du site qui fabriquait la Dépakine et pour lesquels Sanofi a été mis en examen en novembre 2024 dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet de Paris. “Je pense à tous les hommes qui travaillaient là-bas, qui ont respiré du valproate. Aux habitants de la commune. La Dépakine, c’est effrayant parce qu’on découvre de plus en plus de choses et ça concerne énormément de monde. Sanofi ne peut pas continuer à faire comme si de rien n’était.”
Jean-Marc Laurent a envoyé le 20 novembre dernier une lettre ouverte au laboratoire. Il y exprime le souhait d’une “reconnaissance, au moins morale des souffrances engendrées”, “d’une contribution financière réelle au dispositif d’indemnisation, pour que le poids ne repose plus uniquement sur l’argent public.” Il parle “d’informer, de prévenir, de réparer” pour “un scandale dont les répercussions continueront, pendant des décennies, à marquer des milliers d’enfants et de familles.”