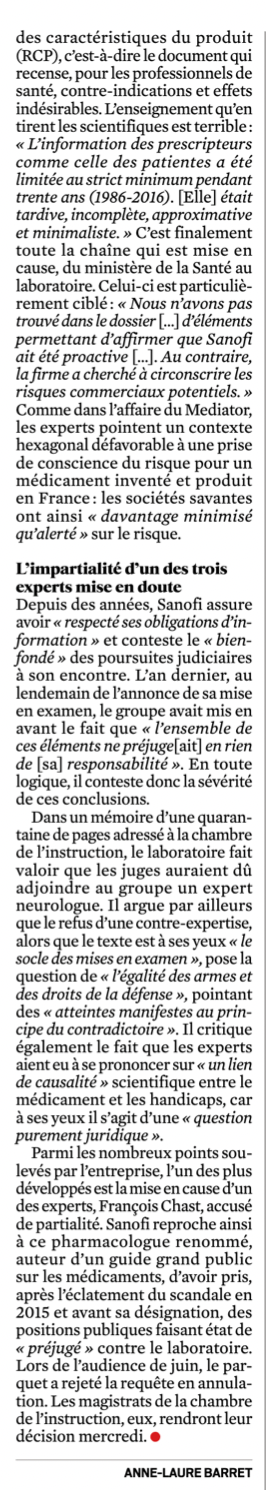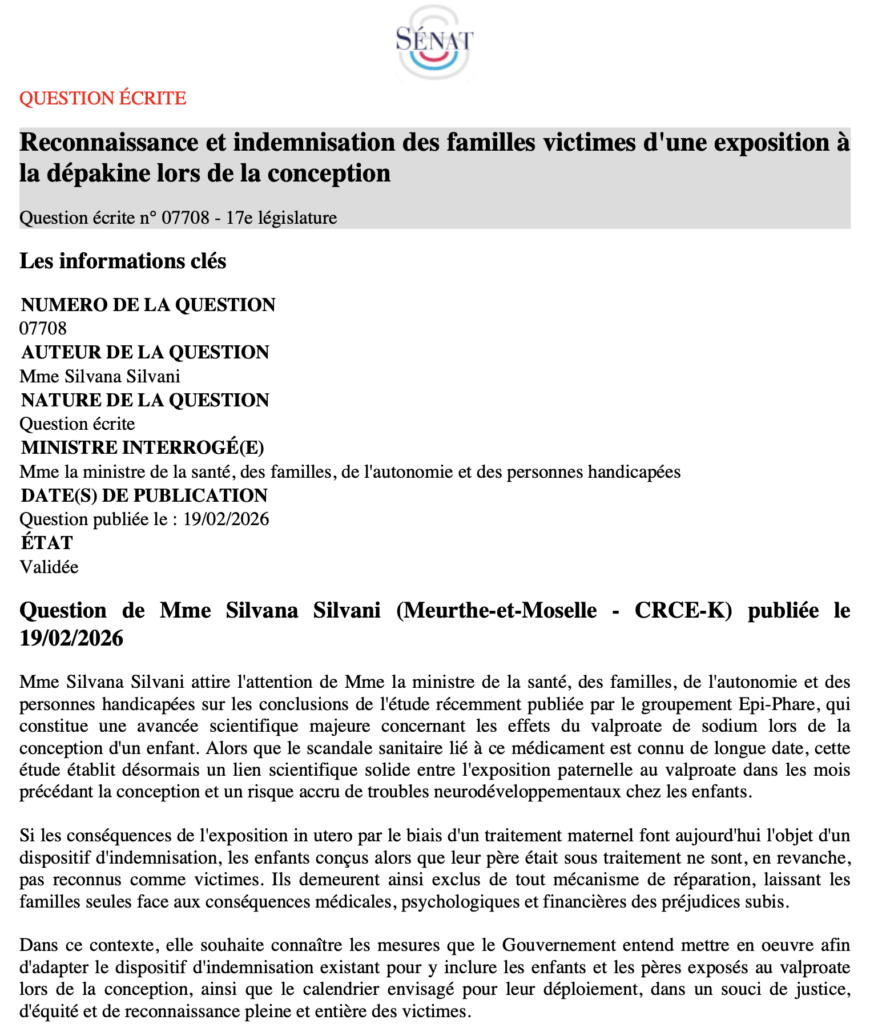Le JDD
Dans un rapport, trois médecins estiment que le risque de malformations lié à la Dépakine, un médicament antiépileptique, était avéré à partir de 1999. Sanofi conteste les conclusions du document, qui a provoqué sa mise en examen : les magistrats doivent statuer cette semaine.
L’affaire de la Dépakine, un médicament contre l’épilepsie qui serait responsable de 2.000 à 4.000 cas de graves malformations et de 17.000 à 30.000 cas de troubles neurodéveloppementaux – ainsi que d’enfants mort-nés et d’interruptions médicales de grossesse –, pourrait connaître un rebondissement cette semaine. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris doit en effet statuer sur la demande faite par Sanofi d’annuler le rapport d’expertise ayant conduit, l’an dernier, à sa mise en examen pour « tromperie aggravée » et « blessures involontaires » puis pour « homicides involontaires ».
Cosigné par trois médecins, le document de 1.195 pages remis aux magistrats en janvier 2020 est une pièce maîtresse de l’enquête pénale ouverte en 2016, après le dépôt de plainte de plusieurs familles dont les enfants sont nés avec des handicaps. Celles-ci accusent le groupe d’avoir tardé à informer les patientes des risques pour le nouveau-né en cas de prise du médicament pendant la grossesse. Comme souvent dans les dossiers sanitaires, l’expertise joue un rôle crucial. Il est donc logique que celle-ci donne lieu à une bataille procédurale, qui a connu son point d’orgue le 9 juin lors de l’audience qui s’est tenue devant la chambre de l’instruction. Egalement mise en examen dans ce dossier, pour « blessures et homicides involontaires par négligence », l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) conteste elle aussi l’expertise.
Lire aussi – Dépakine : une famille face au juge
L’objet de la mission confiée en 2018 au spécialiste des médicaments François Chast, à l’épidémiologiste Paddy Farrington et au généticien Michel Vekemans était notamment de décrire les propriétés de la Dépakine, de déterminer à partir de quand ses effets délétères avaient été mis au jour et d’analyser la réaction du laboratoire et des autorités sanitaires. Le jugement porté par ces médecins, tel qu’il transparaît à la lecture des 38 pages des « conclusions finales » du rapport, est très sévère. Tous trois suggèrent que l’industriel a eu tendance à minimiser les défauts de son produit et que l’ANSM, pourtant chargée de la police sanitaire, a fermé les yeux sur ces failles.
« L’impact a été sous-estimé par la firme »
En préambule, les scientifiques reviennent sur un des éléments clés de ce dossier, qui le distingue de celui du Mediator. Contrairement à la molécule de Servier, qui était dépourvue d’efficacité, la Dépakine, c’est‑à-dire le valproate de sodium, sa substance active, vendue dans une centaine de pays, déclinée sous forme de génériques en France, et également indiquée depuis 1995 dans le traitement de la bipolarité, est un produit précieux… à condition de ne pas être administré à une femme enceinte. Il demeure « aujourd’hui considéré comme un médicament antiépileptique majeur », martèlent les experts tout en rappelant qu’il s’agit du plus « tératogène » des antiépileptiques.
Ces pages se lisent comme la chronique d’un désastre annoncé. Une plongée historique dans plus de 800 études de toxicité permet aux chercheurs d’affirmer que « la toxicité du valproate de sodium à l’égard de l’embryon a été connue dès sa mise sur le marché » en 1967, après des études chez le rat, la souris et le lapin. « Cette information importante, dont l’impact a été sous-estimé par la firme, par les experts [scientifiques] et par les autorités sanitaires, aurait dû attirer l’attention », pointent-ils.
Ensuite, les indices n’ont cessé de s’accumuler pour former à leurs yeux une évidence : « L’exposition prénatale est responsable » des handicaps dont souffrent de nombreux enfants et adultes. Selon les médecins, le risque de malformations majeures (colonne vertébrale, cœur, membres, faciès caractéristique, etc.) lié à la prise de Dépakine est fermement établi à la lumière de travaux épidémiologiques à partir de 1999, date à laquelle ils parlent d' »association avérée ». Concernant les troubles cognitifs et neurodéveloppementaux – touchant le langage, les apprentissages, les comportements et allant parfois jusqu’à un autisme sévère –, les certitudes sont plus tardives : entre 2005 et 2013 selon les affections.
Toute la chaîne est mise en cause
Des lacunes apparaissent également à l’examen des réactions du laboratoire et des autorités de santé telles qu’elles figurent sur la notice du médicament destinée aux patients et le résumé des caractéristiques du produit (RCP), c’est‑à-dire le document qui recense, pour les professionnels de santé, contre-indications et effets indésirables. L’enseignement qu’en tirent les scientifiques est terrible : « L’information des prescripteurs comme celle des patientes a été limitée au strict minimum pendant trente ans (1986-2016). [Elle] était tardive, incomplète, approximative et minimaliste. »
C’est finalement toute la chaîne qui est mise en cause, du ministère de la Santé au laboratoire. Celui-ci est particulièrement ciblé : « Nous n’avons pas trouvé dans le dossier […] d’éléments permettant d’affirmer que Sanofi ait été proactive […]. Au contraire, la firme a cherché à circonscrire les risques commerciaux potentiels. » Comme dans l’affaire du Mediator, les experts pointent un contexte hexagonal défavorable à une prise de conscience du risque pour un médicament inventé et produit en France : les sociétés savantes ont ainsi « davantage minimisé qu’alerté » sur le risque.
L’impartialité d’un des trois experts mise en doute
Depuis des années, Sanofi assure avoir « respecté ses obligations d’information » et conteste le « bien-fondé » des poursuites judiciaires à son encontre. L’an dernier, au lendemain de l’annonce de sa mise en examen, le groupe avait mis en avant le fait que « l’ensemble de ces éléments ne préjuge[ait] en rien de [sa] responsabilité ». En toute logique, il conteste donc la sévérité de ces conclusions.
Dans un mémoire d’une quarantaine de pages adressé à la chambre de l’instruction, le laboratoire fait valoir que les juges auraient dû adjoindre au groupe un expert neurologue. Il argue par ailleurs que le refus d’une contre-expertise, alors que le texte est à ses yeux « le socle des mises en examen », pose la question de « l’égalité des armes et des droits de la défense », pointant des « atteintes manifestes au principe du contradictoire ». Il critique également le fait que les experts aient eu à se prononcer sur « un lien de causalité » scientifique entre le médicament et les handicaps, car à ses yeux il s’agit d’une « question purement juridique ».
Parmi les nombreux points soulevés par l’entreprise, l’un des plus développés est la mise en cause d’un des experts, François Chast, accusé de partialité. Sanofi reproche ainsi à ce pharmacologue renommé, auteur d’un guide grand public sur les médicaments, d’avoir pris, après l’éclatement du scandale en 2015 et avant sa désignation, des positions publiques faisant état de « préjugé » contre le laboratoire. Lors de l’audience de juin, le parquet a rejeté la requête en annulation. Les magistrats de la chambre de l’instruction, eux, rendront leur décision mercredi.
Les dates-clés de l’affaire de la Dépakine
1967 : Mise sur le marché du valproate de sodium sous le nom de Dépakine par le laboratoire Labaz, racheté par Sanofi en 1993. A partir de 1995, la molécule est également indiquée pour traiter les troubles bipolaires.
2015 : L’association de familles Apesac fait éclater le scandale sanitaire.
2016 : Ouverture d’une enquête pénale à Paris.
2020 : Trois experts remettent leur rapport de plus de 1.000 pages aux magistrats. Mise en examen de Sanofi pour « homicides involontaires » et « tromperie aggravée » puis de l’Agence du médicament (ANSM) pour « blessures et homicides involontaires par négligence ».