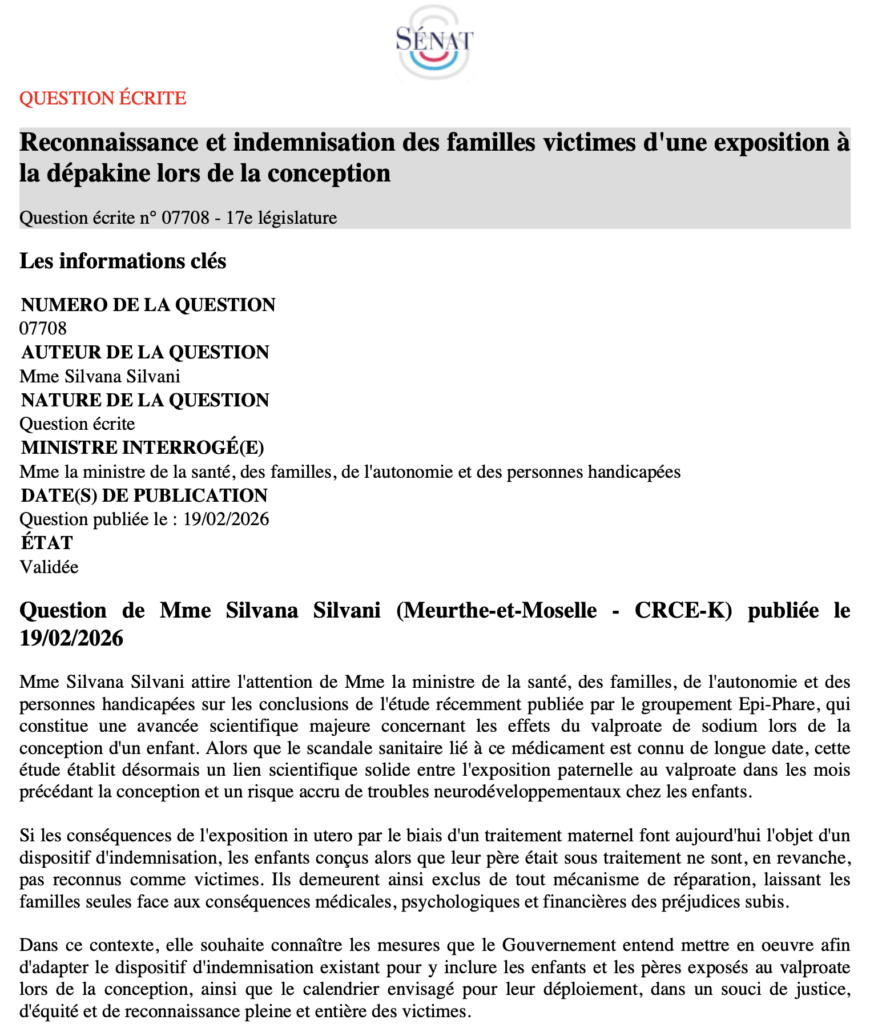Marie Claire
C’est le nouveau scandale sanitaire : les risques que fait courir au fœtus cet antiépileptique de référence sont connus depuis les années 90. Pourtant, rien n’a été mis en œuvre pour empêcher de le prescrire aux femmes enceintes, qui ont eu des enfants handicapés. Après ces révélations, les victimes demandent réparation.
« Ce sujet est tellement horrible… C’est super que Marie Claire y consacre un article afin d’informer les femmes des risques de la prise de ce médicament pour leurs enfants. » La confidence, un brin surréaliste, émane du service de communication de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Un organisme actuellement mis en cause, avec le laboratoire Sanofi , devant le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), pour ne pas avoir informé correctement les utilisatrices de l’antiépileptique Dépakine.
« On n’avait pas à m’imposer cette horreur », déplore Angèle, 37 ans, une des plaignantes. Assistante dans un hôpital de la Creuse, elle a dû s’arrêter de travailler afin de s’occuper de sa fille, née en 2003. La petite a enchaîné les hospitalisations, témoignant de la plupart des symptômes de ce qu’on appelle désormais l’embryofoetopathie au valproate. « Personne n’était capable d’expliquer pourquoi ma fille avait autant de problèmes », se rappelle Angèle. Auxiliaire de vie scolaire, orthophoniste, séances de « neuro feedback »… elle a fait appel à tous les moyens susceptibles d’aider son enfant, sans savoir de quoi celle-ci souffrait. « En 2008, j’ai pensé à la Dépakine, en écoutant une émission de radio qui évoquait les problèmes posés par ce médicament en Angleterre
crédit photo : istock
Effondrée, j’ai eu le sentiment d’avoir empoisonné ma fille, mais quand je demandais aux médecins s’il pouvait y avoir un lien avec mon traitement contre l’épilepsie, on me répondait que non, qu’il n’y avait qu’une chance sur un million que ce soit ça. » Le CHU de Limoges finira tout de même par soulever une suspicion de lien avec la prise de Dépakine. Une relation de cause à effet que les experts nommés par le tribunal de Bobigny devront maintenant établir judiciairement.
Six autres familles sont engagées devant ce même tribunal, mais elles sont déjà 450 à avoir constitué un dossier pour demander des comptes dans cette affaire devenue un vaste scandale sanitaire.
Mis sur le marché en 1967, le valproate de sodium – nom savant de la molécule constituant la Dépakine – fut vite perçu comme une révolution thérapeutique dans la lutte contre l’épilepsie, maladie grave qui touche environ 1 % de la population. Il a donc été prescrit massivement, permettant à quantité de malades d’éviter des crises, et donc de vivre normalement. Le problème, c’est qu’il a fallu attendre 2015 avant qu’on puisse lire sur sa notice d’utilisation que « les enfants exposés in utero présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement ( jusqu’à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas) ».
Par son effet tératogène (provoquant un développement anormal de l’embryon), dans près d’un cas sur deux une femme enceinte soignée à la Dépakine verra donc sa progéniture atteinte : retard mental, troubles du langage, psychomoteurs ou visuels, dysmorphies faciales, autisme… Les effets indésirables sont d’autant plus dévastateurs que les dégâts ont tendance à s’accumuler. On aurait néanmoins mis près de cinquante ans avant de le découvrir – en tout cas, avant d’en tirer les conséquences en matière de prescription et d’information.
Ingrid, Francilienne de 39 ans, prévoit de porter plainte. Ses quatre enfants, âgés de 7 à 13 ans, sont touchés, tout spécialement les deux derniers, jumeaux nés en 2009. Une fille, qui s’avère souffrir de dyspraxie (maladie dite des enfants maladroits, qui peut être entre autres provoquée par un handicap intellectuel), et un garçon diagnostiqué autiste à 3 ans. « L’année suivante, dans le cadre d’une enquête génétique menée par l’hôpital Robert-Debré (à Paris, ndlr), on m’a annoncé que la Dépakine en était responsable – avec une probabilité de 99 % mais qu’on ne pourrait jamais le prouver », confie Ingrid.
Ingrid passe deux ans entre culpabilité et fatalité, avant d’entendre parler de l’association Aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anti-convulsivant (Apesac). « En apprenant que de
très nombreux enfants souffraient des mêmes problèmes que les miens, j’ai entrepris de combattre ceux qui ont bousillé notre vie. La vérité doit être connue. »L’Apesac a été fondée en 2011 par Marine Martin, mère de deux enfants atteints de malformation. Après avoir découvert seule sur Internet que la Dépakine en était probablement la cause, elle a pris modèle sur une association de parents britanniques, pionnière en la matière. La pneumologue Irène Frachon, lanceuse d’alerte du Mediator, a été son autre source d’inspiration. « Elle m’a fait comprendre que, par l’image et les médias, on pouvait atteindre le laboratoire en révélant le scandale. J’ai donc fait appel à son avocat, qui maîtrise à la fois le droit du médicament et l’univers de
la presse. » Engagée personnellement dans plusieurs procédures judiciaires, Marine Martin a attiré vers l’association quelque mille deux cents familles qui se reconnaissaient dans son histoire.
En se liguant avec l’association anglaise qui avait permis de mener une étude de grande ampleur, l’Apesac a par ailleurs contribué à l’adoption, par l’Agence européenne des médicaments, d’un nouveau protocole de soin, en octobre 2014. Celui qui a conduit à la notice de 2015. « Seule l’action des associations a permis de véritablement réévaluer le risque, affirme Marine Martin. Le laboratoire cherche, lui, depuis toujours, à le minimiser. Il a commencé à informer à petite dose alors qu’arrivaient sur le marché les génériques qui allaient rendre son médicament moins rentable. »

crédit photo : getty images – Oppenheim Bernhard
Les médias donnent l’alerte
Chez Sanofi , on s’inscrit en faux, en plaidant ni coupable ni responsable. « Au fur et à mesure de l’évolution des connaissances scientifiques ayant permis d’identifier les effets indésirables potentiels liés à l’utilisation du valproate pendant la grossesse, Sanofi a toujours fait preuve de proactivité pour actualiser l’information », revendique Pascal Michon, son directeur médical. Il assure que chaque nouveau risque identifié a été notifié dans le « résumé des caractéristiques » du produit, destiné aux prescripteurs, et déplore un délai d’enregistrement de trois ans (de 2003 à 2006), imputable à l’Agence française du médicament, pour les retards neurodéveloppementaux, les plus massifs. Ils ne furent ensuite mentionnés dans la notice du médicament qu’en 2010. Et si l’ampleur du risque ne sera véritablement révélée qu’en 2015, on a attendu 2011 pour y indiquer : « vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes enceinte ou en âge de procréer, sauf indication contraire de votre médecin ».
Dans un rapport publié en février dernier, l’Inspection générale des affaires sociales constate « un manque de réactivité » des autorités de santé et du laboratoire Sanofi . Il note que les alertes ont été davantage motivées par des signaux médiatiques que par des données de pharmacovigilance et des publications scientifiques. Est par ailleurs relevé qu’une « doctrine implicite » française consistait à ne pas alarmer les patients afin d’éviter l’arrêt des traitements, risque réel en matière d’épilepsie, dont les crises peuvent être mortelles. La charge de l’information revenait ainsi aux prescripteurs. Un point que souligne Sanofi , renvoyant la balle aux médecins.
Des retards mentaux
Le corps médical a-t-il été défaillant ? Le neurologue Philippe Derambure, président de la Ligue française contre l’épilepsie, assure que non, du moins en ce qui concerne ses confrères. « Cela fait vingt ans qu’on sait qu’il ne faut pas prescrire ce médicament en première intention en cas de grossesse. Le problème est que 90 % des épileptiques ne sont pas suivis par un neurologue, donc l’information ne passe pas bien.

crédit photo : getty images – PhotoAlto/Sigrid Olsson
Mais le risque a toujours été identifié. » Pas pour Anne, restauratrice scolaire de 45 ans, elle aussi mère de jumeaux, nés en 2007 après onze inséminations et quatre fécondations in vitro (Fiv), qui souffrent de troubles autistiques entre autres. « Le neuro logue m’a seulement dit de répartir les doses de Dépakine : matin, midi et soir. » Anne est très loin d’être la seule à avoir consulté un neurologue qui l’a laissée sous Dépakine pendant sa grossesse, n’y voyant pas de problème particulier et ne cherchant pas d’alternative. Elle a, comme beaucoup de femmes qui ont rejoint l’Apesac, pratiqué une ou plusieurs Fiv. Il faut dire que les anti-convulsivants sont également soupçonnés de provoquer l’infertilité.
« L’argument du médecin de campagne qui n’y connaît rien ne tient pas car on est face à des grossesses très suivies par des neurologues et des gynécologues, avec aucun spécialiste pour transmettre l’information, constate Charles Joseph-Oudin, l’avocat de l’Apesac, fort de ses centaines de dossiers. C’est toujours la même histoire : on ne leur a parlé que du risque de spina bifi da, malformation qui se repère à l’échographie, avec la possibilité d’une interruption de grossesse. Donc on continuait la Dépakine. »
Médicament toujours le plus efficace pour traiter l’épilepsie, voire le seul dans certains cas, la Dépakine s’est vu accorder, jusqu’en 2015, le bénéfice du doute quant à ses risques concernant les retards mentaux. On a préféré éviter ceux inhérents aux crises chez les patientes. Des signaux d’alerte ont été mis en sourdine, sous couvert d’incertitude scientifique. Le résultat va aujourd’hui se chiffrer en milliers de victimes. « On nous a imposé des enfants handicapés, et c’est ce risque que je n’aurais pas voulu prendre, enrage Marine Martin.
Si j’avais été informée, j’aurais préféré adopter ou avoir recours à une mère porteuse. De nombreuses femmes étaient prêtes à rester pendant neuf mois dans un lit afin d’éviter tout problème de crise plutôt que de vivre ce cauchemar. Mais on ne nous a pas donné le choix. » Aujourd’hui, l’information est enfi n passée, mais reste l’interrogation sur la faillite d’un système de pharmacovigilance qui a mis près de cinquante ans à faire son travail, plongeant la plupart des victimes entre l’oubli et la prescription. Mais quand on pose la question aux autorités de santé française, la réponse ne vient pas. On ne passe pas au-delà du service de communication.
Source : Marie Claire