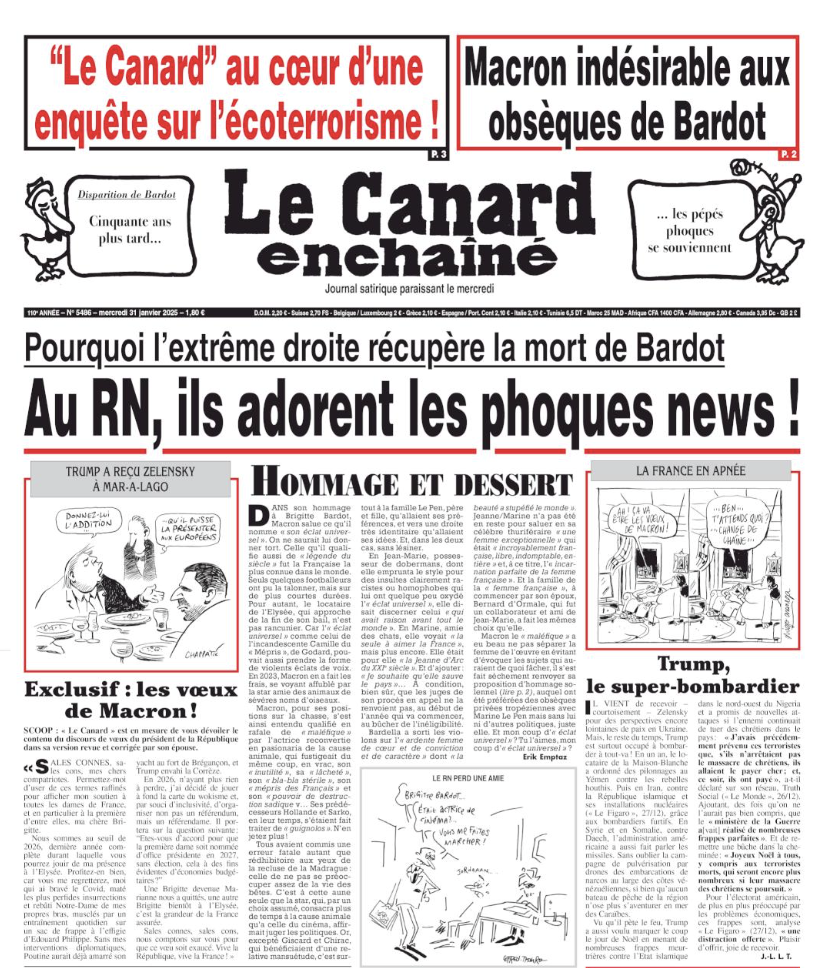Doctissimo
Lorsque l’on évoque le médicament valproate — commercialisé sous le nom de Dépakine — le danger est bien connu pour les femmes enceintes : malformations, troubles du développement… Mais pour la première fois, une vaste étude française suggère que l’exposition paternelle pourrait aussi jouer un rôle dans le devenir de l’enfant. Une alerte salutaire, qui oblige à repenser non seulement la prescription, mais aussi la responsabilité, la prévention et l’accompagnement des futurs pères.
Après des décennies de mise en garde contre le valproate en cas de grossesse, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a publié en novembre 2025 une étude qui met en lumière un « risque accru de troubles neuro-développementaux chez l’enfant dont le père a été traité pendant la spermatogenèse ». Cette révélation ouvre un nouveau chapitre dans le dossier valproate, et impose des précautions inédites pour les hommes.
La Dépakine, un antiépileptique dangereux pour les mères
Depuis plusieurs années, l’usage du valproate (Dépakine) chez les femmes en âge de procréer est sous haute surveillance. Le médicament, utilisé dans l’épilepsie ou les troubles bipolaires, s’est révélé tératogène : il expose à un risque de malformations congénitales estimé à 11 % et à des troubles neuro-développementaux pouvant atteindre 30 à 40 % quand la mère est traitée pendant la grossesse.
Des risques qui avaient déjà conduit à des prescriptions plus encadrées pour les hommes
Jusqu’à présent, la vigilance se concentrait sur la mère. Mais aujourd’hui, l’étude de l’ANSM et du registre national français marque un tournant. Selon le communiqué : « Les résultats montrent une augmentation globale de 24 % du risque de TND chez les enfants de père traité par valproate au moment de la conception, comparativement à ceux dont le père était traité par lamotrigine ou lévétiracétam » (deux autres antiépileptiques).
Cette étude, qui porte sur environ 2,8 millions d’enfants nés en France entre 2010 et 2015, parmi lesquels 4 773 étaient nés d’un père traité par valproate pendant la spermatogenèse, identifie 583 enfants présentant au moins un trouble neuro-développemental : 149 troubles déficit de l’attention (TDAH), 42 troubles du développement intellectuel, 77 troubles du spectre de l’autisme, 294 troubles de la communication, 160 troubles des apprentissages.
Si le risque se double pour le trouble du développement intellectuel (soit +3,5 cas pour 1 000 enfants), il reste « bien moindre » que celui observé quand la mère est exposée à ce médicament. Mais le message est clair : les hommes sous valproate doivent désormais être informés, et les médecins également.
En France, depuis le 6 janvier 2025, la prescription initiale de valproate chez un adolescent ou un homme susceptible d’avoir des enfants est réservée à un neurologue, un psychiatre ou un pédiatre, et la dispensation est conditionnée à une attestation d’information partagée cosignée chaque année.
Vers une indemnisation pour les « papas Dépakine » ?
En mai 2023, une étude initiale réalisée par les laboratoires pharmaceutiques concernés, à la demande du comité de pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments (EMA), a suggéré un risque potentiel de troubles neurodéveloppementaux. Cette découverte a conduit l’ANSM à instaurer des mesures d’information pour les patients et les professionnels de santé. Cette étude nordique a montré un risque variant entre 5,6 % et 6,3 % chez les enfants nés de pères exposés au valproate, contre 2,5 % à 3,6 % pour d’autres antiépileptiques (lamotrigine ou lévétiracétam). Les résultats de l’étude française vont être transmis au niveau européen où l’évaluation se poursuit.
Marine Martin, représentante de l’APESAC, qui avait alerté sur les dangers de la Dépakine en 2016, a révélé avoir été rapidement contactée par environ 80 « pères dépakine ». Ces derniers ont partagé leurs inquiétudes concernant leurs enfants souffrant de troubles autistiques ou de dys. Lors d’une intervention sur France Info, elle a exprimé l’espoir que cette nouvelle étude permettra d’inclure les enfants de ces pères dans le fonds d’indemnisation déjà existant pour les femmes, géré par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. En pleine période de discussions budgétaires, elle sollicite les parlementaires pour modifier ce dispositif afin d’y intégrer les enfants de ces pères.